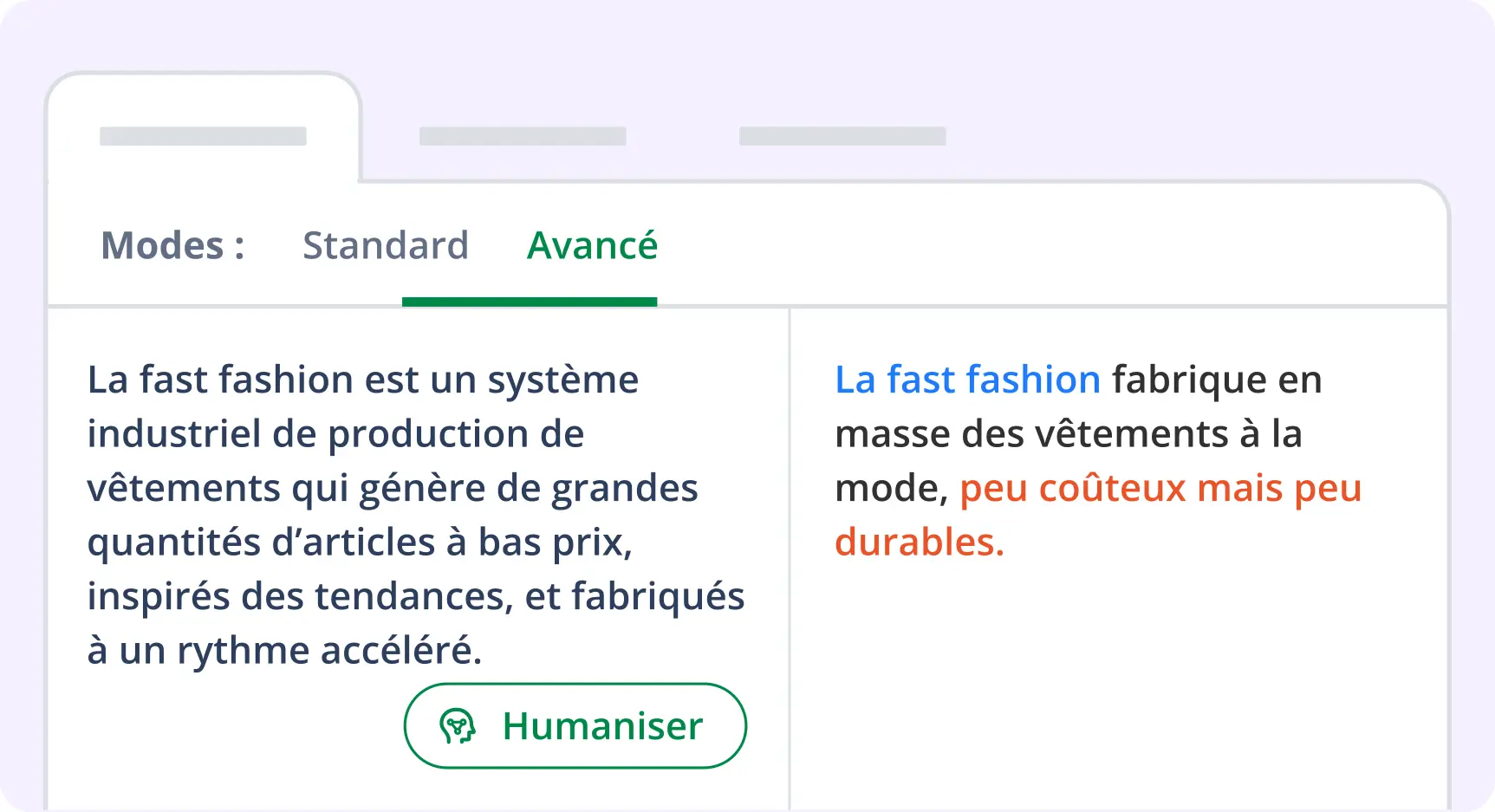Le point de vue interne | Ressorts et caractéristiques
Raconter une histoire, lorsqu’on est romancier ou scénariste, c’est faire des choix. Et parmi ces choix cruciaux, il y a celui de la perspective narrative.
Sa fonction est comparable à celle d’une caméra au cinéma : on peut choisir de poser le boîtier sur l’épaule d’un narrateur qui se baladerait entre tous les lieux et les personnages.
Parfois, la lentille ne fait que capter l’image graphique de ce qu’elle voit, de manière purement objective, quand d’autres fois, elle s’offre le luxe de rentrer dans l’intériorité des personnages observés et de rapporter leurs pensées, opinions et émotions, en sautant d’esprit en esprit.
Ou bien, on peut placer l’objectif dans les yeux et le cerveau d’un personnage en particulier, lequel nous fait alors vivre les évènements sous le prisme de son propre regard et de sa subjectivité, sans que l’on accède à ce que les autres personnages autour de lui pensent ou éprouvent.
Cette dernière option a trait à une focalisation bien spécifique : le point de vue interne.
(Hervé Bazin, Vipère au poing)
Analyse :
Ici, la narration nous donne accès aux pensées du personnage-narrateur (Jean Rezeau, alias Brasse-Bouillon). Les faits et réflexions relatés le sont sous le prisme de sa connaissance globale de la situation et de sa façon de voir le monde qui l’entoure.
Par exemple, les phrases exclamatives, reconnaissables au point d’exclamation qui les termine, expriment sa combativité et sa détermination à fuguer pour échapper au joug de Folcoche — de son vrai nom Paule Pluvignec —, sa mère. Or, il ne s’agit pas de paroles qu’il prononce, et que d’aucuns auraient pu capter en l’écoutant pour les rapporter ; c’est un monologue interne.
Mais attention : si l’on a un peu vite tendance à penser les points de vue externe ou omniscient au « il/elle » et le point de vue interne au « je », les choses sont loin d’être aussi simples…
En effet, votre cerveau, qui redoute plus que tout de sortir de sa zone de confort, fera tout pour vous détourner de votre projet de roman ou de nouvelle en mettant l’accent sur la moindre difficulté que vous pourriez rencontrer.
Heureusement, il existe des astuces pour vous faciliter la tâche, diminuer votre charge mentale, et surmonter votre syndrome de l’imposteur une bonne fois pour toutes.
- On ne le répètera jamais assez : nul besoin de viser la perfection orthographique, linguistique et stylistique durant l’écriture du premier jet. Cependant, si l’idée de laisser traîner des fautes en cours de route vous bloque, un passage sur notre correcteur d’orthographe dernier cri saura éliminer les scories qui auraient pu se glisser sous votre plume sans y avoir été invitées (quelle outrecuidance !).
- En amont, pendant et en aval de l’écriture, notre chat IA s’avérera une aide précieuse pour faciliter vos recherches et répondre à vos questions les plus techniques afin de garantir la précision et la vraisemblance de votre récit.
- Quant à ce labeur qu’est la rédaction d’un synopsis, notre outil de résumé de texte est tout disposé à vous donner un fier coup de pouce !
Table des matières
- Qu’est-ce qu’un point de vue interne ?
- Les caractéristiques majeures au point de vue interne
- Le point de vue interne et le « Je » narratif : une relation non exclusive
- La troisième personne focalisée
- Point de vue interne : exemples
- Extraits de différents points de vue internes
- Quand choisir le point de vue interne ?
- Questions fréquentes sur le point de vue interne
Qu’est-ce qu’un point de vue interne ?
Le point de vue interne est un mode narratif par le biais duquel le lecteur accède à un récit via les perceptions, les sentiments, les sensations et le vécu d’un personnage qui est partie prenante de l’histoire.
Le narrateur interne adopte la perception d’un personnage en particulier. Il a accès à l’entièreté de ses pensées et de son monde intérieur.
Par conséquent, le lecteur perçoit l’univers de l’histoire sous le prisme de sa subjectivité, et doit se contenter des seules informations qu’il possède.
Mettre les bœufs avant la charrue, ou définir la narration
La narration, quel que soit le support qu’elle adopte, désigne au sens large le processus par lequel une histoire, soit une succession d’évènements reliés entre eux, est transmise à un destinataire.
En littérature, ladite histoire est alors racontée à travers le récit d’un narrateur, qui peut être aussi bien extérieur à l’histoire (observateur externe) qu’un de ses personnages.
Les points de vue narratifs
Le point de vue (ou focalisation narrative, voire tout simplement focalisation), en narration, est avant tout une question de perspective.
On distingue trois grands types de points de vue narratifs :
- le point de vue interne,
- le point de vue externe,
- le point de vue omniscient.
Notons qu’un même récit n’est pas forcé de se cantonner au même point de vue tout du long. Ainsi, plusieurs focalisations peuvent se mélanger, alterner au sein de la même histoire. C’est un choix de plus en plus courant, à l’heure où la littérature se veut expérimentale et multidimensionnelle.
- Un roman alterne un chapitre sur deux (ou sur trois) entre le point de vue omniscient et le point de vue interne.
- Dans Double amnésie, un polar de Céline Denjean, le lecteur passe du point de vue de l’Œil, un antagoniste qui darde un regard ne présageant rien de bon sur ceux qu’il observe de loin, à celui de différents protagonistes de la famille Le Guen après le meurtre du père. Entre ces deux focalisations, on retrouve aussi des chapitres concernant l’enquête policière conduite par la gendarme Éloïse Bousquet, qui eux, sont écrits au point de vue omniscient.
La façon dont Céline Denjean (qui est coutumière de la méthode) construit son récit permet au lecteur de suivre l’histoire sur différents niveaux, du côté des victimes comme celui des coupables, sans oublier bien sûr les enquêteurs, sur lesquels ce même lecteur a une longueur d’avance. Enfin, c’est ce qu’il croit… Céline Denjean connaissant très bien son métier d’autrice de roman à suspense, elle s’attache surtout, par cette méthode, à mener son lecteur en bateau et à l’orienter sur des fausses pistes jusqu’aux révélations finales.
- Dans Double amnésie, un polar de Céline Denjean, le lecteur passe du point de vue de l’Œil, un antagoniste qui darde un regard ne présageant rien de bon sur ceux qu’il observe de loin, à celui de différents protagonistes de la famille Le Guen après le meurtre du père. Entre ces deux focalisations, on retrouve aussi des chapitres concernant l’enquête policière conduite par la gendarme Éloïse Bousquet, qui eux, sont écrits au point de vue omniscient.
- Un roman alterne entre plusieurs points de vue internes, pour nous exposer au regard de plusieurs protagonistes de la même histoire en simultané.
- Dans Entre chiens et loups, de Malorie Blackman, le récit alterne entre les points de vue internes de Perséphone et Callum, les deux personnages principaux, qui, bien qu’amis et secrètement amoureux l’un de l’autre, appartiennent à deux castes opposées. L’une, privilégiée, les Primas, opprime l’autre, les Nihils, sur la seule base de sa couleur de peau. Ce choix de la part de Blackman vise à mettre en avant le fossé matériel et émotionnel existant entre les deux personnages, donnant ainsi du relief aux obstacles qui s’opposent à leur amour dans un monde de ségrégation où tout les éloigne.
Cette construction narrative porte d’ailleurs un nom : il s’agit d’un roman choral, ou roman polyphonique (= à plusieurs voix).
Évidemment, on ne saurait opérer de hiérarchie entre ces points de vue : aucun n’est fondamentalement meilleur ou plus brillant qu’un autre. Tout dépend de l’histoire que l’on veut raconter, et de comment on veut la raconter…
A contrario, tous les points de vue ne disent pas la même chose, se porter sur l’un ou sur l’autre ne doit pas se décider de manière purement arbitraire ; utiliser le « plouf-plouf » dans ce cas est une très, très mauvaise idée.
Pour un roman bien construit et maîtrisé, le choix de tel point de vue au profit d’un autre s’appuie forcément sur une vision globale de son histoire et de son récit, qui doit faire l’objet d’une véritable réflexion en amont.
Aussi, les habitudes des lecteurs de tel ou tel genre peuvent entrer en compte.
Par exemple, la romance se prête particulièrement au point de vue interne à la première personne, et ses adeptes en sont très friands, alors que les romans de fantasy usent plus souvent du point de vue omniscient, lequel n’a pas son pareil pour exposer toutes les caractéristiques d’un monde imaginaire (rapport à votre worldbuilding).
Ou alors, si vous maîtrisez suffisamment le sujet, vous pouvez vous risquer à prendre le contrepied de la norme implicite pour vous démarquer… Dans l’écriture de fiction, tout est possible, tant que tout est cohérent.
Pourtant, parfois, le PDV est remplacé par un « POV ». Ce « POV » n’est autre que l’abréviation de son équivalent anglais Point of View. Largement popularisé au début des années 2000 par les communautés de jeunes auteurs, cet acronyme s’est répandu grâce à l’avènement de la fanfiction et du succès des plateformes telles que Wattpad, mais pas que…
Il faut comprendre que l’étude de la narratologie dans le monde francophone n’est que très récente, et sa reconnaissance académique encore en cours. Pendant longtemps, le monde littéraire refusait d’accepter qu’écrire pouvait s’apprendre grâce à des techniques formelles. La compétence, l’effort ? Que nenni ! Les auteurs, les vrais, ont vu la fée Pimprenelle se pencher sur leur berceau à la naissance et leur insuffler le don de plume, ce que l’on nomme dans tout bon billet germanopratin – en référence à Saint-Germain-des-Prés, quartier de Paris et fief historique de la littérature française – qui se respecte le talent (ou le génie, c’est selon). Une vision bourgeoise que l’on admet heureusement surannée aujourd’hui — à l’exception de quelques irréductibles qui hantent les cafés du quartier Odéon — grâce au travail de nos amis anglo-saxons, qui ont largement pavé le chemin.
La diffusion de contenus francophones originaux concernant l’écriture créative n’a, par conséquent, débuté que très nouvellement. Les décennies précédentes, retard oblige, nous avions plutôt tendance à traduire les doctrines américaines… d’où la propagation massive de l’abréviation anglaise.
Soyez toutefois rassuré(e) : les deux veulent dire la même chose.
Les caractéristiques majeures au point de vue interne
Comprendre les spécificités et les ressorts du point de vue interne est indispensable afin de faire le meilleur choix pour votre récit.
- Avec la narration interne, personnage et narrateur se confondent ; seul l’auteur est distinct.
- Grâce au point de vue interne, l’univers du récit est présenté à travers la conscience, les perceptions sensorielles et les émotions d’un personnage, qui les interprète et les décrit selon sa propre subjectivité. Il est donc nécessairement influencé par son vécu et sa psyché ; c’est l’anti-point de vue objectif.
Ainsi, le même récit, mais raconté par un autre personnage, prendrait une tout autre coloration. - L’usage du point de vue interne propose par voie de conséquence un contrat tacite avec le lecteur : ce dernier accepte que le narrateur puisse lui mentir, consciemment ou non. Le risque d’illusion ou de quiproquo est important.
- Le point de vue interne favorise, sauf à dérouler une plume maladroite qui le sortirait de l’histoire (ce qui est un risque majeur posé par cette focalisation, nous y reviendrons), l’identification du lecteur au narrateur. Elle crée une sensation de proximité, d’intimité.
- Si un récit est écrit au point de vue interne tout du long, alors celui-ci doit se limiter à exposer les informations dont dispose son personnage. Conséquence : ce que le personnage ne sait pas, alors le lecteur ne peut pas le savoir non plus.
Astuce : Pour contourner cette limitation sans perdre en pouvoir immersif, une alternance de points de vue (plusieurs points de vue internes, ou un point de vue interne alterné avec un point de vue omniscient) peut être envisagée.
Le point de vue interne et le « Je » narratif : une relation non exclusive
On a souvent tendance à croire que le point de vue interne passe obligatoirement par l’usage de la première personne (soit les pronoms personnels sujets « je » et « nous »), mais c’est un biais.
En fait, le point de vue interne est le plus riche à ce niveau, puisqu’il est le seul qui puisse s’incarner à travers les trois types de personne narrative.
- Je fixai la porte, le ventre serré. Et si quelqu’un rôdait derrière, épiant mon méfait ? C’était là ma plus grande crainte, j’avais trop à perdre à ce petit jeu. Je n’eus pas le temps de me poser davantage la question, le bois grinça et la lumière du couloir pénétra la pièce.
- Elle fixa la porte, le ventre serré. Et si quelqu’un rôdait derrière, épiant son méfait ? C’était là sa plus grande crainte, elle avait trop à perdre à ce petit jeu. Elle n’eut pas le temps de se poser davantage la question, le bois grinça et la lumière du couloir pénétra la pièce.
- Tu fixas la porte, ton ventre serré. Et si quelqu’un rôdait derrière, épiant ton méfait ? C’était là ta plus grande crainte, tu me l’avais confié pas plus tard que ce matin même ; tu avais trop à perdre à ce petit jeu. Tu n’eus pas le temps de te poser davantage la question, le bois grinça et la lumière du couloir pénétra la pièce.
Analyse :
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le point de vue interne à la première personne et le point de vue interne à la troisième personne sont très proches en termes de construction. On le voit aux extraits précédents : entre l’un et l’autre, seul le pronom personnel sujet change, car les enjeux sont exactement les mêmes, et le personnage-narrateur identifié avec certitude.
Pour le premier, identifier un point de vue interne est très facile : avec le « je », aucun doute possible.
Pour le deuxième, cela se corse, car la troisième personne peut être portée par les trois types de focalisations. Cependant, le fait que l’extrait se concentre uniquement sur le ressenti et les connaissances d’un seul personnage, et non de plusieurs comme le ferait un point de vue omniscient, permet de détecter un point de vue interne.
Enfin, le point de vue interne à la deuxième personne, beaucoup plus rare en littérature (car c’est l’usage de la deuxième personne en tant que sujet qui l’est tout court), subit quant à lui quelques légères modulations. En effet, le risque avec cette technique est de glisser vers un « faux » point de vue omniscient sans s’en rendre compte, alors que l’utilisation du « tu » (ou du « vous », mais c’est encore plus rare) implique que le narrateur s’adresse à un tiers, sans pour autant accéder à son psychisme et à son intériorité.
Lorsque vous croisez un ami dans la rue et que vous vous adressez à lui, vous ne lui décrivez pas ses propres pensées ou sensations, qui vous sont inconnues (à moins d’être télépathe, et de vouloir vous faire beaucoup d’ennemis…). Comme dans la vie, vous ne savez de cet ami que ce que vous avez vu, entendu et senti… et ce qu’il a bien voulu vous dire.
D’où l’ajout de la précision « tu me l’avais confié pas plus tard que ce matin même ». Ce n’est pas obligatoire, mais utile pour éviter tout quiproquo, particulièrement dans les récits à suspense. Un lecteur, encore plus à l’heure où il dispose d’un choix d’œuvres pléthorique et fait face à une capacité d’attention mise à mal par l’omniprésence des réseaux sociaux, aime qu’on le prenne un minimum par la main…
Un point de vue narratif, comme son nom l’indique, c’est avant tout une question de focalisation choisie, pas de pronom ou de personne.
La troisième personne focalisée
Ironiquement, la troisième personne focalisée — qui n’est qu’une autre manière de désigner le point de vue interne à la troisième personne — est de loin la plus exploitée dans le roman contemporain (de très loin, même).
Ce type de focalisation ne se place pas du point de vue d’un personnage en particulier, mais exit également le narrateur omniscient.
La troisième personne focalisée prend le meilleur des deux mondes : l’histoire est racontée à la troisième personne, mais le lecteur n’a accès qu’aux pensées et sensations d’un seul personnage.
(Arttu Tuominen, Tous les silences)
Analyse :
Dans l’extrait ci-dessous, le point de vue interne est clairement établi : on accède aux pensées, aux réflexions du personnage de Linda, mais pas à ceux d’Oksman. Par exemple, on ne sait pas vraiment si Oksman apprécie le son de la voix de Linda, ce n’est qu’une supposition de la part de cette dernière.
La narration n’apporte aucune confirmation, ni aucun contrepied à ce sujet.
Le lecteur devra donc en tirer ses propres conclusions sur la base de ce qu’il sait de Linda et Oksman, et prendre le risque de se fourvoyer.
Tout le génie de cette narration est qu’elle parvient à favoriser la connexion du lecteur avec le personnage incarné tout en posant – avec une dextérité toute calculée – sur le narrateur une cape d’invisibilité (contrairement à un « je » plus fort, plus incisif dans un écrit, qui marque sa présence, comme s’il murmurait à l’oreille du lecteur).
De cette manière, le lecteur en vient à oublier qu’on lui raconte une histoire, car il est trop occupé à la vivre.
À quelques exceptions expérimentales près, c’est exactement ce que recherche la littérature fictionnelle, et en particulier la littérature de genre.
De ce fait, si votre but est de limiter la distraction du lecteur tout en entretenant une connexion émotionnelle avec votre protagoniste pour qu’il s’identifie à lui, la troisième personne focalisée est un choix tout à fait approprié, si ce n’est le meilleur de tous.
Désormais, vous comprenez mieux pourquoi la fiction actuelle l’a érigé en point de vue chouchou…
Pour une plume riche, au lexique varié, n’hésitez pas à user de synonymes, par exemple au sein de vos incises. Pour cela, un catalogue de verbes de parole (soit des synonymes de Dire) peut toujours s’avérer utile.
Et si vous manquez encore d’inspiration, le reformulateur de texte peut vous suggérer des termes voisins, dont le sens pourrait bien varier légèrement et vous ouvrir à de nouvelles pistes.
Car, aussi frustrant que ce soit, c’est aussi cela, écrire : rédiger une phrase, la réécrire au moins 10 fois, pour finalement la supprimer le lendemain au profit d’une autre idée.
Point de vue interne : exemples
Rien de tel pour intégrer un concept que de le mettre en pratique. Et la pratique, pour les auteurs, ne passe pas seulement par l’écriture à proprement parler : « Lire, c’est déjà écrire », a dit à très juste titre la romancière Paule Constant.
Exemples d’œuvres littéraires écrites au point de vue interne
| Œuvres classiques | Œuvres contemporaines |
|
|
La majorité de ces romans sont écrits à la première personne du singulier, mais ce n’est pas le cas de tous…
La Métamorphose de Kafka, par exemple, est écrit à la troisième personne du singulier, tout comme Widowland de C. J. Carey, tandis que Délicieuse de Marie Neuser emploie la deuxième personne du singulier… sur pas moins de 470 pages.
Extraits de différents points de vue internes
En fait, il y a presque autant de points de vue internes que d’auteurs qui s’y sont essayés… À chacun sa manière de faire ; tant que le regard se limite à celui d’un personnage en particulier sur un passage donné et ne pratique pas de « télépathie » avec les autres protagonistes, le contrat est respecté.
Il serait toutefois intéressant, pour bien comprendre les possibilités qu’offre cette focalisation, de voir ce que cela peut donner en contexte avec toutes les personnes narratives.
Point de vue interne à la première personne : exemples
Ils ont dû être d’une dominicale banalité, « bonjour chérie, tu as bien dormi ? », et je me suis probablement fait réprimander pour avoir déserté le dîner si tôt. J’ai dû m’excuser, et l’embrasser pour me faire pardonner. La seule chose dont je sois sûre à propos de ce matin-là, c’est qu’il n’a rien remarqué. »
(Mathieu Menegaux, Je me suis tue)
(Hannelore Cayre, La Daronne)
(John Burnside, Scintillation)
On remarque que chacun de ces extraits est porteur d’une voix très marquée et singulière, à l’image du personnage qui les raconte à la première personne.
Ainsi, la sidération du personnage abusé dans le premier extrait se fait ressentir à travers le style, plutôt dépouillé, passif, presque clinique. Idem pour le troisième extrait, dont on perçoit la sensation d’oppression du narrateur, prisonnier d’un univers apocalyptique aux terres ravagées, grâce aux longues phrases sans respiration. Quant au deuxième extrait, le registre se fait familier, et la voix cynique, à l’image de la personnalité de Prudence, la narratrice, un personnage particulièrement irrévérencieux.
C’est là une caractéristique majeure de la narration interne à la première personne : plus encore que toutes les autres, la forme se doit d’épouser l’état d’esprit du personnage, ainsi que l’environnement dans lequel il évolue.
Point de vue interne à la deuxième personne : exemples
Tu en es où, dans tes fouilles ? Tu t’es réfugié où ? Dans quelle lâcheté plus ou moins heureuse et que tu t’escrimes à justifier ? Tu veux aller où ? »
(Daniel Arsand, Moi qui ai souri le premier)
[…]
Vous n’alliez pas vous en tirer comme ça. Ni elle, la cambrioleuse de vie, ni toi, le lotophage robotisé par les appâts de ta roulure. »
(Marie Neuser, Délicieuse)
Ces deux extraits, très incarnés eux aussi, présentent une différence majeure.
Dans celui de Marie Neuser, la narratrice s’adresse assez clairement à un personnage que l’on devine propre à l’histoire, et qui ne peut être nous, lecteurs (lorsqu’on lit des saillies du type « en prenant conscience de ton absence absolue de désolation face à la mienne » ou « toi, le lotophage robotisé », on comprend que l’autrice n’attend pas de nous que l’on s’identifie à celui qu’elle pointe du doigt).
Le lecteur est alors placé en position d’observateur clandestin, comme s’il était caché derrière un rideau et écoutait le long monologue que Martha — c’est ici le nom de la narratrice — adressait à celui qu’elle aimait.
Dans un autre registre, l’extrait tiré d’un roman de Daniel Arsand présente une adresse beaucoup plus universelle. Ce « tu », ce « toi », ce pourrait être tout le monde… alors pourquoi pas nous, pourquoi pas vous ?
C’est comme si le doigt de l’auteur-narrateur (car le narrateur est bel et bien l’auteur ici ; on le sait en lisant le livre en entier) sortait d’entre les pages du livre et venait se braquer sur notre poitrine, pour nous prendre à partie… nous contraignant finalement à devenir, en quelque sorte, un personnage.
Cette méthode narrative porte elle aussi un nom : elle brise le quatrième mur.
Le point de vue interne à la deuxième personne n’est pas seulement une coquetterie littéraire ou un terrain de jeu pour les plumes les plus averties. Non seulement elle n’a pas son pareil pour multiplier l’intensité des sentiments et nous donner l’impression d’être dans la confidence de quelque chose que l’on n’est pas censé savoir, mais elle possède également ce pouvoir de briser le quatrième mur.
Voilà, assurément, une focalisation narrative sous-exploitée !
Point de vue interne à la troisième personne : exemples
(Louise Mey, Les Ravagé(e)s)
Il aurait aimé ajouter des choses comme : “Je n’ai jamais aimé que toi de cette façon depuis que je suis né, tu es l’incarnation de ce qui me semble essentiel lorsqu’on vit, tu captes chaque particule de mon air, j’étouffe de trop te sentir en moi, si tu te brûles le doigt, je veux me brûler la main, ma vie ne s’arrangera qu’avec ton regard sur moi, un mot rapide de toi vaut seize histoires d’amour, lorsque tu m’écoutes, j’ai l’impression d’exister, je détruirais tous les murs du monde si je pouvais t’apercevoir une seconde à travers l’un d’eux, couvre-moi de toi, […], je ne peux attendre pour m’imaginer vivre avec toi, le pire serait de perdre la mémoire, je comprends enfin la douleur quand nous sommes séparés, prends, connais, digère tout de moi, le reste du monde n’est vide que parce que je sais que tu n’y es pas, j’aimerais te retrouver sans avoir peur, j’aimerais t’appeler mon chéri sans me sentir ridicule, j’aimerais vivre avec toi, j’aimerais mourir quand je te vois, je t’aime je t’aime je t’aime”.
Mais c’est déjà bien assez pour aujourd’hui.
Ils ne reparleront jamais de ce moment-là. »
(Thomas Louis, Le Processus de tendresse)
Les deux extraits ci-dessus proposent un usage contrasté (sur le plan de la forme, du moins) du point de vue interne à la troisième personne (ou troisième personne focalisée).
Le premier est assez classique : en tant que lecteur, on connaît les pensées d’Alex, qui nous sont rapportées avec un phrasé et un vocabulaire somme toute courants, sans parure.
Le deuxième, en revanche, va à l’encontre de ce que la troisième personne se voudrait être selon certains analystes du récit, notamment grâce à cette tirade imaginaire du personnage de Yann (le narrateur) envers Cyril, son amant. Cela dit, même au début du passage, la plume ne se contente pas du tout d’une prose mécanique, scénaristique, ou à l’os ; elle cherche à toucher à travers des images fortes (la « profondeur qui brûle »), des figures de style telles que des gradations, des anaphores.
On peut souvent lire que la troisième personne focalisée, pour les besoins du fond, pratique l’économie de mots, rogne sur l’originalité et l’intensité stylistique.
Rien n’est plus faux.
Elle est, comme toutes les autres, ce que son auteur veut bien en faire.
Le style de celui-ci a le droit de s’y affirmer sans demander de comptes à qui que ce soit.
Quand choisir le point de vue interne ?
Choisir entre point de vue interne, point de vue omniscient et point de vue externe (bien que ce dernier fasse plutôt figure d’exception, et que le dilemme se pose plus naturellement entre les deux premiers) est rarement évident, et pour cause : l’enjeu est de taille.
En effet, le choix de la focalisation est, avec celui de la temporalité du récit, le plus important que vous ayez à faire sur le plan technique.
Autant crever l’abcès tout de suite : il n’y a pas de formule ou de doctrine toute faite, et celui qui vous vendra le contraire est un menteur.
Hormis l’autobiographie qui appelle ipso facto un point de vue interne, tous les genres romanesques peuvent adopter tous les points de vue en théorie.
Cependant, nuançons quelque peu : opter pour un mauvais point de vue (et on entend par « mauvais point de vue » une narration qui manquerait son objectif et passerait à côté de son lecteur) pourrait desservir votre intention littéraire, de même que partir d’emblée sur une focalisation en adéquation avec les idées et sentiments que vous voulez faire passer pourrait sublimer votre récit à moindre effort.
Partant de ce constat, il peut être judicieux de vous orienter vers le point de vue interne si :
- Vous cherchez à favoriser l’immersion psychologique du lecteur dans votre univers, plus que n’importe quel autre aspect.
- Vous souhaitez entretenir un doute quant à la perception des personnages, ou cultiver un mystère en dissimulant sciemment des informations à votre lecteur pour qu’il en prenne connaissance en même temps que les personnages.
- La dynamique de suspense dans votre roman doit d’abord reposer sur les zones d’ombre et les non-dits.
- Votre priorité est l’exploration de la psychologie de vos personnages, comme dans le roman psychologique.
- Vous aimez quand la forme épouse le fond, et notamment la manière de penser d’un personnage.
- Votre personnage a une personnalité tellement marquée et originale qu’il serait indécent de ne pas vous servir de cette singularité pour donner une voix unique à votre récit.
- Le plus important pour votre histoire, ce n’est pas tant ce qui arrive que la manière dont le personnage touché le vit, et ce que cela signifie et change pour lui.
À l’inverse, si vous recherchez une vision panoramique sur un univers incarné par de multiples personnages ou visez la neutralité descriptive, sans filtre subjectif, voire souhaitez que votre voix d’auteur prime sur celle du personnage, alors l’usage du point de vue interne devrait être questionné plutôt deux fois qu’une…
Vous pouvez tout à fait détester écrire à la première personne, et quand même choisir le point de vue interne.
Le plus important, en fin de compte, est de choisir une focalisation narrative qui sert votre intention littéraire, et avec laquelle vous vous sentez suffisamment à l’aise pour y exposer votre style.
Notons enfin que, même s’il est fondamentalement plus commode de choisir le bon point de vue dès le départ et de s’y tenir, rien ne vous empêche, si vous réalisez que votre décision initiale n’était pas la bonne ou ne correspond plus à la tournure qu’a prise votre projet, de réécrire les passages concernés en adoptant un autre point de vue.
Essayer, tâtonner, se tromper et recommencer, reste encore la meilleure façon d’apprendre un art. Si c’est le cas, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie : vous sentez votre récit, ses ondes, ses forces et ses faiblesses. C’est au moins aussi indispensable que la maîtrise des techniques de narration.
James Baldwin, par exemple, fuyait l’usage du point de vue interne, qui corrompait selon lui tout effet de vérité, quand pour Bernardine Evaristo, il entretient un effet d’intimité salutaire pour un récit dans lequel on voudrait réduire la distance entre personnage et lecteur.
Dany Laferrière, dans son Journal d’un écrivain en pyjama, tend à se méfier d’un point de vue interne unique, en ce qu’il rendrait un récit linéaire, donc ennuyeux selon lui. Ainsi, il préconise plutôt les angles multiples, afin de donner au lecteur la chance d’aborder « la même histoire avec plusieurs sensibilités différentes ».
Récentes, ces divisions ? Moins qu’on pourrait le croire, puisque déjà au début du 20e siècle, Alberto Moravia reprochait au point de vue omniscient son caractère « bourgeois », grandiloquent, et plaidait ainsi pour une narration interne afin de plaire au plus grand nombre.
Enfin, pour la baronne du thriller psychologique à l’américaine, Patricia Highsmith, ses homologues se posent beaucoup trop de questions : le point de vue interne est naturellement prisé par les écrivains, car il est « plus pratique, tout simplement ».
Des points de vue aussi contradictoires que personnels, pour notre plus grand bonheur de lecteur, et qui montrent aux auteurs, s’il le fallait encore, qu’il n’y a pas qu’une manière de faire.
Au fait, avez-vous remarqué que les avis d’auteurs connus à ce sujet nous viennent essentiellement d’écrivains anglais ou américains ? Il n’y a rien de très étonnant à cela : les journalistes ou critiques littéraires n’ont commencé à parler « boutique » avec les auteurs français que depuis peu, préférant les amener jusqu’alors sur un terrain plus personnel lors de leurs entretiens. Et cela fait sens, quelque part : après tout, pourquoi le génie inné porté aux nues par la tradition littéraire française s’abaisserait à se poser des questions aussi bassement matérielles que celles du point de vue ou de la temporalité ? Seule l’intuition de l’écrivain, son talent, pèse dans la balance.
La « technique narrative », ou cachez ce gros mot qu’on ne saurait voir…
Questions fréquentes sur le point de vue interne
- Qu’est-ce que le point de vue interne externe omniscient ?
-
Le point de vue interne externe omniscient n’existe pas ; cette notion, composée de termes contradictoires, constituerait un non-sens à elle seule.
En fait, il existe trois grands types de points de vue narratifs, qui s’opposent les uns aux autres :
- le point de vue interne,
- le point de vue externe,
- et le point de vue omniscient.
Un doute sur l’orthographe d’un mot ? Le correcteur orthographique QuillBot est toujours disponible pour dissiper vos hésitations et débarrasser vos textes des coquilles qui peuvent s’y glisser. Personne n’est parfait, n’est-ce pas ?
Citer cet article QuillBot
Nous recommandons l’utilisation de sources fiables dans tous les types de communications. Vous souhaitez citer cette source ? Vous avez la possibilité de copier-coller la citation ou de cliquer sur le bouton « Citer cet article » pour ajouter automatiquement la citation à notre générateur de sources gratuit.
Tihay, L. (9 janvier 2026). Le point de vue interne | Ressorts et caractéristiques. Quillbot. Date : 24 février 2026, issu de l’article suivant : https://quillbot.com/fr/blog/ecriture-creative/point-de-vue-interne/